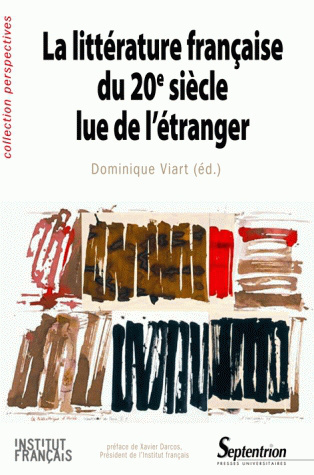La littérature française du 20e siècle lue de l'étranger
Première édition
À l'heure où la mondialisation menace la présence de la culture française sur la scène internationale et celle de la littérature dans le champ culturel, cet ouvrage manifeste l'importance de la littérature française pour les Universités étrangères... Lire la suite
A l'heure où l'on débat de la présence de la culture française sur la scène internationale, et de celle de la littérature dans le champ culturel, cet ouvrage manifeste l'importance de la littérature moderne et contemporaine française dans les Universités étrangères. Il établit et commente l'état actuel des recherches, travaux et publications qui lui sont consacrés dans le monde.
Il fournit aussi une précieuse réflexion sur l’évolution des méthodes critiques :après la domination successive des écoles formalistes et structurales, puis, dans un grand nombre de pays, de celles issues de la « French Theory » et du « déconstructionnisme », aucune école ni méthode ne semble avoir aujourd'hui pris la relève, et la recherche universitaire, désormais plus syncrétique, préfère croiser des approches de nature diverse.
Mais qu’en est-il en fait ? Peut-on constater des particularités observables selon les diverses zones géographiques, linguistiques et les diverses aires culturelles ?
Ces études, présentées par les meilleurs spécialistes mondiaux de la littérature française moderne et contemporaine, montrent quelles sont, depuis le basculement d’un siècle à l’autre, les esthétiques les plus volontiers étudiées, les approches critiques privilégiées et leurs articulations éventuelles avec les autres disciplines de la pensée dans les principaux pays ouverts à notre littérature.
Spécifications
- Éditeur
- Presses Universitaires du Septentrion
- Édité par
- Dominique Viart,
- Avec
- Ruth Amossy, Paul Aron, Nadia Butman, Fumio Chiba, Xavier Darcos, Paul de Sinety, Karin Gundersen, Barbara Havercroft, Sjef Houppermans, Marie-Pascale Huglo, Thomas Hunkeler, Zhu Jing, Galina Kouznetzsova, Petr Kylousek, Charif Majdalani, Jochen Mecke, Colin Nettelbeck, Gerald Prince, Gianfranco Rubino, Pierre Schoentjes, Michael Sheringham,
- Collection
- Perspectives
- ISSN
- 16213211
- Langue
- français
- Catégorie (éditeur)
- Catalogue Septentrion > Littératures > Lettres et littératures françaises
- Catégorie (éditeur)
- Catalogue Septentrion > Littératures
- BISAC Subject Heading
- LIT000000 LITERARY CRITICISM
- Code publique Onix
- 05 Enseignement supérieur
- CLIL (Version 2013-2019 )
- 3435 LITTÉRATURE GENERALE > 3643 Essais littéraires
- Description public visé
- Grand public cultivé. Enseignants et responsables culturels de France et de la France à l'étranger Analystes et décideurs politiques Presse et média
- Date de première publication du titre
- 30 novembre 2011
- Subject Scheme Identifier Code
- Classification thématique Thema: Littérature : histoire et critique
Livre broché
- Date de publication
- 30 novembre 2011
- ISBN-13
- 978-2-7574-0207-8
- Ampleur
- Nombre de pages de contenu principal : 286
- Code interne
- 1258
- Format
- 16 x 24 cm
- Poids
- 431 grammes
- Prix
- 17,00 €
- ONIX XML
- Version 2.1, Version 3