Les rapports juridiques dans le couple sont-ils contractuels ?
First Edition
Xavier Labbée aime les frontières. Après avoir disserté de la distinction des personnes et des choses, voici qu'il réfléchit aux confins du droit de la famille et du droit des obligations. La question qu'il pose peut surprendre, car il y a des lustres que les civilistes ne se querellent plus sur le point de savoir si le mariage est un contrat ou une institution. L'ordre public baigne à tel point le statut matrimonial que personne ne voudrait soutenir qu'il appartient à la volonté des époux d'alléger le poids de leur chaîne. Et, même si pour les couples hors mariage le notariat a pu préconiser une convention de concubinage à l'instar de droits étrangers, force est de constater qu'il recommande prudemment d'en limiter le champ aux seules relations patrimoniales des contractants, le domaine extra-patrimonial relevant davantage de déclarations d'intentions que d'engagements strictement définis. Et pourtant ! Parler d'ordre public, n'est-ce pas déjà faire appel à une notion que le droit des contrats consacre ? Ainsi, s'agissant de sa formation, la nullité pour erreur sur les qualités du conjoint n'a-t-elle pas totalement rejoint le droit commun des contrats ? S'agissant de ses effets, n'est-il pas exact qu'au quotidien la volonté commune des conjoints organise des modes de vie qui transgressent les règles légales ? et qu'à défaut de pouvoir contraindre à les agréer indéfiniment, elle prive au moins de pouvoir en invoquer le caractère injurieux ? Quant à dissoudre l'union, les formes non-contentieuses de divorce n'évoquent-elles pas immanquablement la résolution par mutuus dissensus ? Et que dire du concubinage ? Le législateur ne le réglemente toujours pas, ce qui vaut mieux qu'une mauvaise législation. Le contrat n'est-il pas dès lors de lege lata la meilleure voie à explorer ? Les conventions de concubinage peuvent assurer la mise en commun de moyens matériels, prévoir le principe et les modalités d'une contribution, régler les conséquences d'une rupture... Est-il si choquant qu'elles y ajoutent la promesse d'une assistance ou d'une fidélité ? fût-ce à durée déterminée, ce qui somme toute peut s'avérer plus rigoureux qu'un engagement résiliable à tout moment ? Xavier Labbée explore tout cela. Occasion de présenter le droit du couple, non pas à la manière impersonnelle des encyclopédies, mais de façon vivante, autour d'une thèse. Occasion aussi de réfléchir aux évolutions de notre législation et de notre société. Le triomphe de l'égoïsme a conduit de plus en plus de couples à préférer l'union libre au mariage et le législateur, volontiers démagogue, à faciliter au nom du respect de la liberté individuelle le « démariage ». Tout en déplorant cette évolution - et le titre de sa première partie est révélateur -, Xavier Labbée constate successivement que « le mariage s'abaisse au rang des contrats » tandis que « les situations hors mariage s'élèvent au rang des contrats ». Un éminent auteur estimait naguère souhaitable de « déréglementer - un peu - le mariage, réglementer - un peu - le concubinage ». A lire Xavier Labbée, la contractualisation des rapports de couple paraît bien l'un des moyens de ce rééquilibrage.
Specifications
- Publisher
- Presses Universitaires du Septentrion
- Author
- Xavier Labbée,
- Preface by
- Jean Hauser,
- Collection
- Droit / manuels
- ISSN
- 12582786
- Language
- French
- Tags
- Economic history, economy, Nord - Pas-de-Calais
- Publisher Category
- Septentrion Catalog > Law, political science > Law
- Publisher Category
- Septentrion Catalog > Economical Sciences, Social Sciences
- Publisher Category
- Septentrion Catalog > Law, political science
- BISAC Subject Heading
- LAW000000 LAW
- Onix Audience Codes
- 05 College/higher education
- CLIL (Version 2013-2019)
- 3259 DROIT
- Title First Published
- 1996
- Subject Scheme Identifier Code
- Thema subject category: Jurisprudence and general issues
Paperback
- Publication Date
- 26 November 2012
- ISBN-13
- 978-2-7574-0412-6
- Extent
- Main content page count : 326
- Code
- 1383
- Dimensions
- 16 x 24 cm
- Weight
- 534 grams
- List Price
- 25.00 €
- ONIX XML
- Version 2.1, Version 3
Google Book Preview
Contents
Partie I
Les leviers de l'histoire bancaire
Chapitre 1
La problématique de l'adaptabilité du banquier
Hubert Bonin & Jean-François Eck
Chapitre 2
Segmentations bancaires, structures industrielles et organisation de l'État. Les banques et le financement des entreprises régionales en France (des années 1840 aux années 1970)
Michel Lescure
Chapitre 3
Les sources de l’histoire bancaire aux Archives nationales du monde du travail
Françoise Bosman
Gersende Piernas
Partie II
Lille-Roubaix-Tourcoing : analyse d’un foyer entrepreneurial
Chapitre 4
Territoire et dynamique industrielle : des configurations historiquement différenciées (France, xixe-xxe siècles)
Jean-Claude Daumas
Chapitre 5
Lille-Roubaix-Tourcoing des années 1950 aux années 1990 : une place économique en quête de restructuration
Jean-François Eck
Partie III
Système bancaire et économie régionale
Chapitre 6
« Cent banques pour une place » : panorama de la métropole bancaire de Lille-Roubaix-Tourcoing en 1850-1914
Matthieu de Oliveira
Chapitre 7
Les enjeux du métier bancaire dans la région lilloise, entre 1850 et 1914
Jean-Luc Mastin
Chapitre 8
La hiérarchie du financement des entreprises du Nord de la France au xixe siècle
Muriel Petit-Kończyk
Chapitre 9
Le Crédit du Nord à Lille-Roubaix-Tourcoing dans les années 1950-1980 : apogée et crise de reconversion
Sabine Effosse
Partie IV
La Société générale à Lille-Roubaix-Tourcoing
Chapitre 10
La Société générale à l’assaut de la place de Lille-Roubaix-Tourcoing. Une Parisienne au coeur des dynasties industrieuses nordistes (entre les deux guerres mondiales)
Hubert Bonin
Chapitre 11
Le réseau d’agences de la Société générale à Lille-Roubaix-Tourcoing : repères historiques et iconographiques
Marjolaine Meeschaert et Sylvie Guillaudeau
Chapitre 12
La Société générale à Lille-Roubaix-Tourcoing et la gestion de la « banque de flux »
Serge Éveillé
Chapitre 13
Témoignage. Mes fonctions à l’agence de Roubaix de la Société générale (dans les années 1950 et 1970)
Raymond Gély
Conclusion générale
Jean-François Eck
Résumés
Index

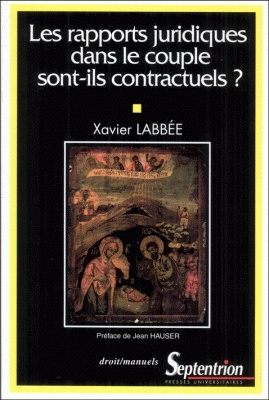
Taylor & Francis online
(http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13507486.2013.871927?journalCode=cerh20#.UtlE9vtKGHs).