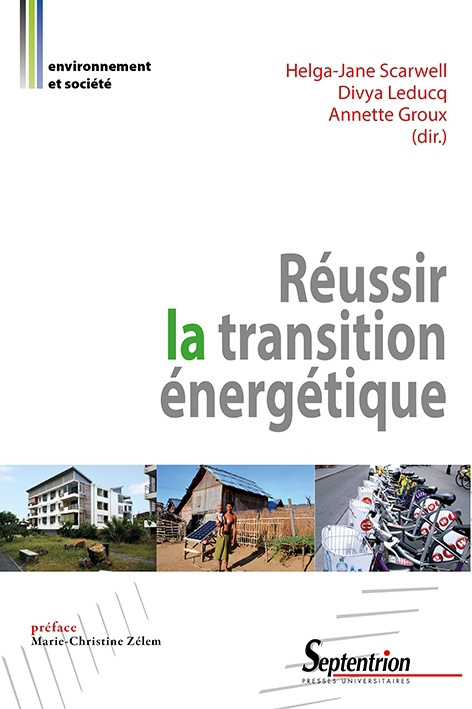Réussir la transition énergétique
Première édition
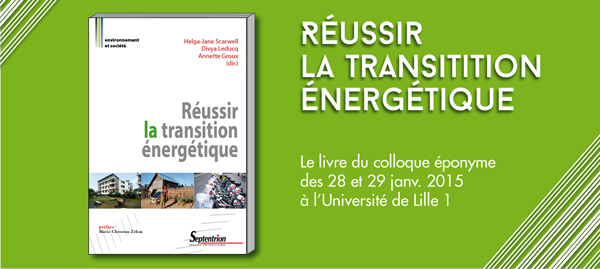
La transition écologique, énoncée au Sommet de Rio+20, inscrit au cœur des agendas des États et des collectivités la volonté de mise en œuvre simultanée de plusieurs objectifs – réduction des émissions de gaz à effet de serre, promotion des énergies renouvelables – tout en interrogeant nos besoins. En France, cette question s'est focalisée sur la problématique de la transition énergétique.
Loin de faire consensus, cette notion donne néanmoins naissance à une recrudescence de solutions techniques de verdissement (rénovation des bâtiments, éco-conception des produits, revalorisation des déchets…) dont l’apogée se retrouve dans la promotion des démarches « intelligentes » – smart – à l’échelle des réseaux et des villes. Or, d’autres modèles d’efficacité ou de sobriété énergétique ne pourraient-ils pas cohabiter ? Ne conviendrait-il pas d’interroger l’échelle intermédiaire de l’aménagement du territoire et de la planification afin de mesurer les potentialités de transition énergétique urbaine ou rurale ? L’action sur les systèmes techniques ne passerait-elle pas aussi par une revalorisation efficace des connaissances et savoir-faire locaux ? Ne peut-on pas croire que l’insignifiance de l’échelle individuelle ait un impact significatif à l’échelle collective ?
Si toute activité humaine entraîne une consommation d’énergie, la façon dont les hommes maîtrisent celle-ci est au fondement de nos modes de vie et de l’organisation de nos sociétés. L’ouvrage se compose de trois parties mettant en évidence la diversité géographique et thématique des leviers possibles du changement autour d’une question centrale : comment réussir la transition énergétique ?
La première partie permet d’interroger la mise en œuvre opérationnelle locale de la transition énergétique et ses limites dans la réponse qu’elle apporte à la crise environnementale globale. La seconde propose une vision prospective de ce que devrait être la transition énergétique en développant des pistes prenant en compte l’individu, la technologie et l’épaisseur du territoire. Sont exposés, dans la dernière partie de l’ouvrage, des scénarios régionaux de sobriété énergétique et de transformations sociétales axés sur les modes de vie et de société afin de réduire notre dépendance à l’énergie.
Spécifications
- Éditeur
- Presses Universitaires du Septentrion
- Édité par
- Helga-Jane Scarwell, Divya Leducq, Annette Groux,
- Avec
- Stéphane Baly, Olivier Blanpain, Julia Burdin, Bertrand Cassoret, Maximin Chabrol, Guillaume Christen, Alain Dubresson, Lucas Durand, Kévin Duruisseau, Sabine Girard, Julie Gobert, Loïc Grasland, Isabelle Hajek, Philippe Hamman, Sylvy Jaglin, Mathieu Le Dû, Gildas Le Saux, Mathias Louis-Honoré, Joël Meissonnier, Gisèle Lila Miyagou, Clément Morlat, Constantin Napoléon, Sophie Némoz, Patrick Palmier, Bernard Pecqueur, Maryvonne Prévot, Daniel Roger, Marcel Ruchon, Nicolas Senil, Matthieu Stivala,
- Préface de
- Marie-Christine Zelem,
- Collection
- Environnement et société
- ISSN
- 17716152
- Langue
- français
- Catégorie (éditeur)
- Catalogue Septentrion > Environnement, santé > Environnement et développement durable
- Catégorie (éditeur)
- Catalogue Septentrion > Environnement, santé
- Catégorie (éditeur)
- Catalogue Septentrion > Sciences économiques, sciences sociales
- BISAC Subject Heading
- SCI000000 SCIENCE
- Code publique Onix
- 05 Enseignement supérieur
- CLIL (Version 2013-2019 )
- 3377 HISTOIRE > 3069 TECHNIQUES ET SCIENCES APPLIQUEES
- Date de première publication du titre
- 06 janvier 2015
- Subject Scheme Identifier Code
- Classification thématique Thema: Sciences : généralités
Paperback
- Date de publication
- 15 juillet 2015
- ISBN-13
- 978-2-7574-0951-0
- Ampleur
- Nombre de pages de contenu principal : 248
- Code interne
- 1580
- Format
- 16 x 24 cm
- Poids
- 401 grams
- Prix
- 25,00 €
- ONIX XML
- Version 2.1, Version 3
- Date de publication
- 15 juillet 2015
- ISBN-13
- 978-2-7574-1171-1
- Ampleur
- Nombre de pages de contenu principal : 248
- Code interne
- 1580P
- Protection technique e-livre
- None
- Taille du fichier
- 1843 KB
- Prix
- 18,00 €
- ONIX XML
- Version 2.1, Version 3
Google Livres Aperçu
Sommaire
Introduction :
la fin du monde est remise à une date ultérieure
Xavier Labbée
Première partie
Le droit
Chapitre I
L'homme augmenté
Jean Hauser
Chapitre II
« Du Code Noir de Louis XIV aux trois lois de la robotique d'Isaac Asimov »
Ugo Bellagamba
Chapitre III
L'homme augmenté à l'épreuve de la distinction des personnes et des choses
Pascal Labbée
Chapitre IV
Le statut juridique du robot
Pierre-Jérôme Delage
Chapitre V
Médecin ou mécanicien ?
Une approche cybernétique de la pratique médicale en Droit
Céline Aludaat-Dujardin
Chapitre VI
L'homme augmenté et la responsabilité pénale
Audrey Darsonville
Chapitre VII
L’homme augmenté et la responsabilité civile
Geoffroy Hilger
Deuxième partie
L’éthique
Chapitre I
L’homme augmenté et les lois bioéthiques
Jean-Pierre Marguénaud
Chapitre II
L’homme normal, l’homme ancestral, l’homme augmenté.
Dr Francis Vasseur
Chapitre III
Réprimer pénalement les interventions biotechniques à finalité transhumaniste ?
Damien Roets
Chapitre IV
L’homme augmenté : un regard chrétien sur le corps
Stanislas Deprez
Chapitre V
L’homme dopé face au sport
Romain Boffa
Chapitre VI
L’homme augmenté et le droit du travail
Bernard Bossu
Jean Philippe Tricoit
Chapitre VII
Le « soldat augmenté »
Pierre Lecocq
Chapitre VIII
L’allongement de la vie du malade, atteint de sclérose latérale amyotrophique, par la technique de la ventilation invasive : choix ou contrainte ?
Véronique Danel Brunaud
Chapitre IX
L’homme augmenté et la mort
Bruno Py
Chapitre X
L’homme congelé
Éléments prospectifs d’un régime juridique de l’homme congelé
Anne-Blandine Caire
Synthèse