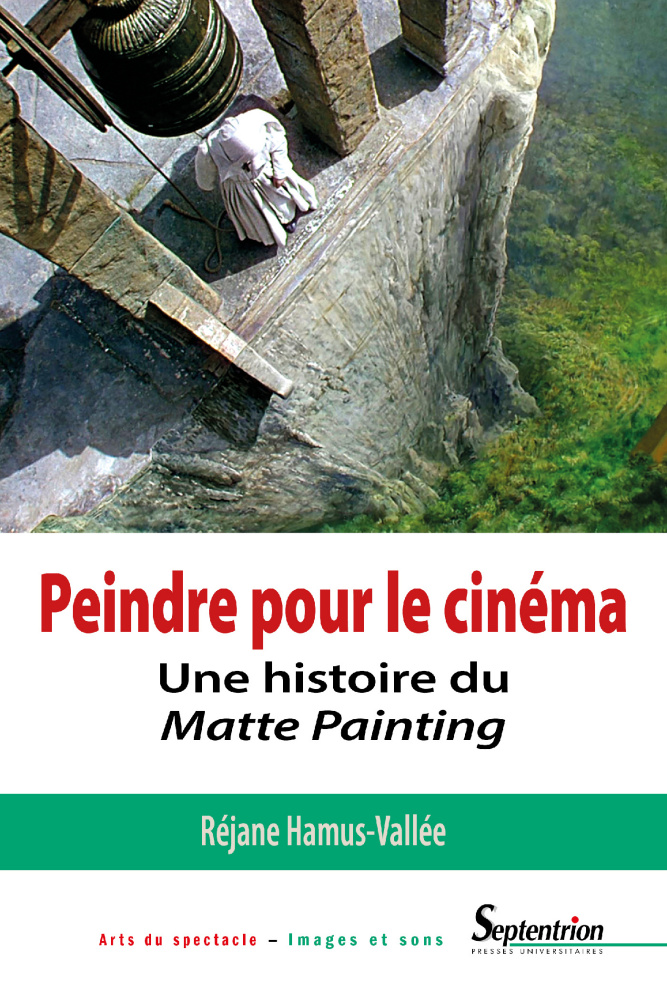Peindre pour le cinéma
Une histoire du Matte Painting
Première édition
Le Matte Painting permet de combiner en un même plan large un décor réel et son prolongement sous forme d'une peinture (réalisée avec des pinceaux sur du verre ou créée numériquement). Cet ouvrage propose une histoire de cette technique et questionne le rôle des effets spéciaux au cinéma. Lire la suite
Présent depuis les débuts du cinématographe et traversant toute l'histoire du cinéma, le Matte Painting permet de combiner en un même plan large un décor réel et son prolongement sous forme d'une peinture, qu’elle soit réalisée avec des pinceaux sur du verre ou créée numériquement. Son agencement avec d’autres plans est si parfait que le spectateur en est rarement conscient. L’illusion est ainsi complète pour le serment du Jeu de paume de Napoléon d’Abel Gance (1927), la façade de l’Inquirer de Citizen Kane d’Orson Welles (1940), la visite d’un musée est-berlinois du Rideau déchiré d’Alfred Hitchcock (1965), la forêt du Retour du Jedi (Richard Marquand, 1983) ou celle d’Avatar (James Cameron, 2008)…
Cet ouvrage propose une histoire de cette technique, de ses ancêtres directs à ses différentes technologies cinématographiques. Il analyse la façon dont les matte painters ont cherché et cherchent toujours à introduire ce décor truqué en harmonie avec l’esthétique de la mise en scène. Ainsi, par l’étude du Matte Painting, c’est le rôle des effets spéciaux au cinéma qui est questionné, au moment où le numérique renouvelle les enjeux même de l’illusion cinématographique.
Spécifications
- Éditeur
- Presses Universitaires du Septentrion
- Auteur
- Réjane Hamus-Vallée,
- Collection
- Arts du spectacle - Images et sons
- ISSN
- 19554893
- Langue
- français
- Catégorie (éditeur)
- Catalogue Septentrion > Arts > Arts plastiques
- Catégorie (éditeur)
- Catalogue Septentrion > Arts > Cinéma, images et sons
- Catégorie (éditeur)
- Catalogue Septentrion > Arts
- BISAC Subject Heading
- ART000000 ART > ART057000 ART / Film & Video > ART020000 ART / Techniques / Painting
- Dewey (abrégé)
- 700-799 Arts > 750 Painting & paintings > 790 Recreational & performing arts
- Code publique Onix
- 05 Enseignement supérieur
- CLIL (Version 2013-2019 )
- 3667 ARTS ET BEAUX LIVRES > 3689 Cinéma
- Date de première publication du titre
- 08 septembre 2016
- Subject Scheme Identifier Code
- Classification thématique Thema: Arts : généralités
Classification thématique Thema: Art digital, vidéo et des nouveaux médias
Classification thématique Thema: Manuels de peinture, de dessin et d’art
- Date originale
- 2016
Livre broché
- Date de publication
- 08 septembre 2016
- ISBN-13
- 978-2-7574-1381-4
- Ampleur
- Nombre de pages de contenu principal : 300
- Code interne
- 1677
- Format
- 16 x 24 x 2,5 cm
- Poids
- 477 grammes
- Prix
- 32,00 €
- ONIX XML
- Version 2.1, Version 3
- Date de publication
- 08 septembre 2016
- ISBN-13
- 978-2-7574-1528-3
- Illustrations
- 30 illustrations, couleur/ 14 illustrations, noir et blanc
- Ampleur
- Nombre de pages de contenu principal : 300
- Code interne
- 1677P
- Protection technique e-livre
- Aucun
- Prix
- 24,00 €
- ONIX XML
- Version 2.1, Version 3
ePub
- Date de publication
- 08 septembre 2016
- ISBN-13
- 978-2-7574-1520-7
- Illustrations
- 30 illustrations, couleur/ 14 illustrations, noir et blanc
- Ampleur
- Nombre de pages de contenu principal : 300
- Code interne
- 1677E
- Protection technique e-livre
- Aucun
- Prix
- 24,00 €
- ONIX XML
- Version 2.1, Version 3
Pack de titres multiples
- Date de publication
- 08 septembre 2016
- ISBN-13
- 978-2-7574-1536-8
- Illustrations
- 30 illustrations, couleur/ 14 illustrations, noir et blanc
- Ampleur
- Nombre de pages de contenu principal : 300
- Code interne
- 1677L
- Format
- 16 x 24 x 2 cm
- Poids
- 612 grams
- Prix
- 35,00 €
- ONIX XML
- Version 2.1, Version 3
Google Livres Aperçu
Sommaire
Remerciements
Introduction
Partie 1.
Un siècle (et plus) de Matte Painting. De la mission californienne à la mission pandorienne
Chapitre 1. Une archéologie du Matte Painting
Le trompe-l'œil, un cousin proche ou lointain ?
Le décor peint, de la convention au naturalisme
La retouche photographique, Matte Painting avant l'heure
Chapitre 2. Les pionniers : des débuts difficiles (1907-1919)
Les essais de Norman O. Dawn
Le décor post-Première Guerre mondiale : faire « vrai » (trop vrai)…
Ne rien dire, mais faire : la culture du secret
Chapitre 3. L’essor international de la technique, les années 1920
Walter Percy Day, un peintre anglais en France
Réduire ou augmenter ? Vers une banalisation de la technique.
La guerre des brevets
Chapitre 4. La généralisation des années 1930, premier âge d’or de la technique
L’ère du chef, une standardisation des pratiques
Une explosion des techniques de compositing
La concurrence des miniatures suspendues, Day vs. Wilcke et Minine
Chapitre 5. Les mutations technologiques de 1940 à la fin des années 1950
La couleur : on change tout, on ne change rien
De plus en plus de mouvements, les systèmes de « motion control »
La quête de l’espace et du temps : le péplum en Cinémascope
Chapitre 6. La crise des années 1960 à 1970 : la fin d’une génération
Le tournage en extérieur, un choix économique, technique et esthétique
L’exception Disney
Du film catastrophe à la science-fiction, la notion de genre
Chapitre 7. Le renouveau des années 1980, un deuxième âge d’or
Le « modèle » Star Wars
La génération ILM : naissance du « film à effets spéciaux » ?
En France aussi, une timide (re)naissance
Chapitre 8. Le numérique, renaissance ou achèvement ?
Un changement radical : la décennie 1990
À nouvelle technique, nouveau métier ? Le DMP (Digital Matte Painter)
Studio et caméra virtuels
Partie 2.
Transformer la peinture en film : le cadre juste, le détail juste, le mouvement juste
Chapitre 1. L’indétectable détecté ou le détectable indétecté
Photogénie, ou le faux plus le faux donne le vrai
L’effet sans la cause, effet spécial ou effet banal ?
L’exception : quand la peinture est faite pour montrer la peinture
Chapitre 2. Cadrer, éclairer : révéler le décor
Gros plan ou plan d’ensemble, la « juste » distance
Citizen Kane, la lumière capturée
L’impressionnisme de Whitlock, peindre avec la lumière
Chapitre 3. La question du détail, trop ou pas assez ?
Diriger le regard du spectateur
Le détail authentifiant, des « gags » de Whitlock aux oiseaux migrateurs
Trop de détails (numériques) tue le détail ? L’empire contre-attaque de 1980 vs. L’empire contre-attaque de 1997
Chapitre 4. Du refus du mouvement à une esthétique du mouvement
Le mouvement de caméra, un tour de force technico-esthétique
Le zoom arrière, de l’infiniment petit à l’infiniment grand
La caméra virtuelle, caméra mouche ?
Partie 3.
Pour une esthétique de la rencontre : entre l’homme et la peinture, entre les images, entre le son et l’image, entre l’image et le texte
Chapitre 1. La rencontre de l’homme et de la peinture, la frontière ou la contagion
Cacher la ligne de cache
L’homme, centre du Matte Painting ?
Les hommes avalés par la peinture : la figuration
Chapitre 2. Le montage, ni trop ni trop peu : la règle des 5 secondes
Quand Koulechov rencontre Bazin
Voir/percevoir, Hitchcock et les effets imperceptibles
Ne jamais monter deux peintures à la suite
Chapitre 3. Le son fait la peinture
Le bruit fait la peinture
La musique fait la peinture
La voix ne fait pas la peinture
Chapitre 4. Le plan paysage, personnage à part entière ?
Les fonctions du décor
L’establishing shot (plan d’établissement) ou plan de situation
Le plan-choc, un triple niveau de lecture
Conclusion
Index des films cités
Index des noms cités
Bibliographie