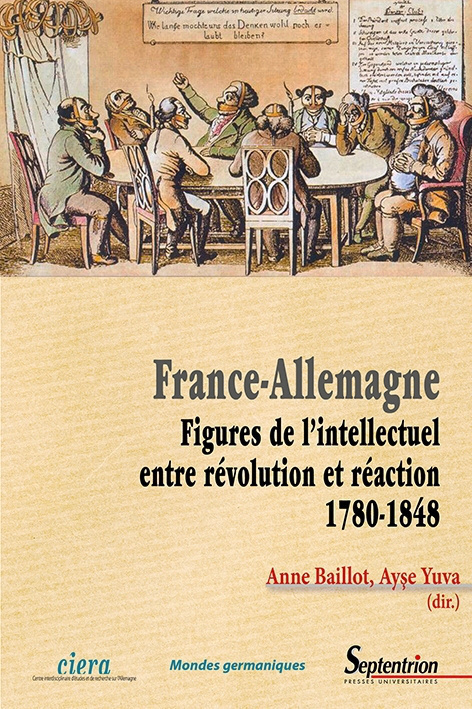France-Allemagne
Figures de l'intellectuel, entre révolution et réaction (1780-1848)
Première édition
De la mort de Voltaire à la révolution de 1848, les savants, philosophes et écrivains redéfinissent leur rôle politique, dans le sillage d'une Révolution française perçue comme étant l’oeuvre des philosophes. Les intellectuels s’interrogent sur les effets politiques de leurs textes, les conditions d’une participation aux charges administratives et éducatives, de leur fonctionnarisation ou d’une prise de parole qui touche un public plus large que le cercle savant.
À rebours d’une histoire qui les présente en héros sous la forme de l’opposant ou du grand écrivain, les études réunies ici mettent en lumière les rapports de force inhérents aux réseaux d’intellectuels et les conceptions parfois divergentes qu’ils développent, notamment sur la pureté du savoir théorique. À travers l’étude de certaines figures marquantes telles que Johann Gottlieb Fichte ou Germaine de Staël, de réseaux comme celui des membres de l’Institut ou d’événements comme l’affaire des « sept de Göttingen », cet ouvrage éclaire aussi bien la dimension sociale que réflexive de ces prises de position politiques.
L’approche se veut ici pluridisciplinaire, associant analyses historiques, littéraires et philosophiques ; elle met en évidence les effets de miroirs entre intellectuels français et allemands, et revient sur la revendication de généalogies occasionnellement transfrontalières.
Spécifications
- Éditeur
- Presses Universitaires du Septentrion
- Avec
- Jean-Luc Chappey, Anne Durand, Stéphanie Genand, Jean-François Goubet, Sylvie Le Moël, Charlotte Morel, Alain Patrick Olivier, Luc Vincenti, Stéphane Zékian,
- Édité par
- Anne Baillot, Ayşe Yuva,
- Collection
- Mondes germaniques
- ISSN
- 19513526
- Langue
- français
- Catégorie (éditeur)
- Catalogue Septentrion > Littératures > Lettres et littératures étrangères > Pays germaniques et scandinaves
- Catégorie (éditeur)
- Catalogue Septentrion > Littératures > Lettres et littératures étrangères
- BISAC Subject Heading
- LIT000000 LITERARY CRITICISM
- Code publique Onix
- 05 Enseignement supérieur
- CLIL (Version 2013-2019 )
- 3643 Essais littéraires
- Date de première publication du titre
- 21 février 2014
- Subject Scheme Identifier Code
- Classification thématique Thema: Littérature : histoire et critique
Livre broché
- Date de publication
- 21 février 2014
- ISBN-13
- 978-2-7574-0675-5
- Ampleur
- Nombre de pages de contenu principal : 210
- Code interne
- 1474
- Format
- 16 x 24 cm
- Poids
- 336 grammes
- Prix
- 22,00 €
- ONIX XML
- Version 2.1, Version 3
- Date de publication
- 21 février 2014
- ISBN-13
- 978-2-7574-0707-3
- Ampleur
- Nombre de pages de contenu principal : 210
- Code interne
- 1474P
- Protection technique e-livre
- Aucun
- Prix
- 16,00 €
- ONIX XML
- Version 2.1, Version 3
Google Livres Aperçu
Sommaire
Introduction
Anne Baillot, Ayşe Yuva
Friedrich Heinrich Jacobi, « philosophe et hommes de lettres » entre les Lumières et l'Idéalisme. À la conquête du pouvoir intellectuel ?
Sylvie Le Moël
Rousseau, Kant et la révolution : la force du pouvoir instituant
Luc Vincenti
Questions sur le « pouvoir des intellectuels » en France dans le moment 1800
Jean-Luc Chappey
« Un petit peuple isolé, sans alliés et sans amis » : Les écrivains et l'Institut au tournant du XIXe siècle
Stéphane Zékian
« Je suis entrée dans cette littérature allemande » : De l’Allemagne ou les vertus de l’intercession féminine
Stéphanie Genand
La raison pure peut-elle être pratique ? La figure du philosophe allemand au début du XIXe siècle en France
Ayşe Yuva
Verklärung über Aufkärung : Fichte ou éduquer à vivre les idées
Charlotte Morel
Le savant comme politique ou pur scientifique. Engagement fichtéen et détachement herbartien lors de la catastrophe de Göttingen
Jean-François Goubet
Qu’est-ce qui fait l’intellectuel ? Les professeurs de l’université de Berlin et leur patriotisme (1810-1820)
Anne Baillot
Hegel et la Révolution française
Alain Patrick Olivier
Ruge et les Annales franco-allemandes
Anne Durand